Multinationales / Europe de la défense
Europe de la défense
Après des décennies de paix, le peuple européen s'est soudainement retrouvé menacé par la guerre.
Mars 2023

Après des décennies de paix, le peuple européen s'est soudainement retrouvé menacé par la guerre. Ce choc, provoqué par l'invasion russe en Ukraine, va sans doute changer les fondements de l'Union Européenne, un projet de paix né après la Seconde guerre mondiale.
Pour beaucoup, l’Union européenne est un projet pacifique, c’est à ce titre d’ailleurs qu’elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Mais la voilà désormais obligée de devenir une puissance militaire. Comment un tel paradoxe va-t-il pouvoir continuer à exister ? En réalité, les États membres travaillent depuis longtemps à une politique de défense commune… avec des résultats plus ou moins bons.Des centaines de milliards d’euros seront dépensés pour renforcer l’Europe de la Défense dans les années à venir. Mais tout cet argent dépensé permettra-t-il vraiment d’assurer la sécurité de l’UE ? Et comment l’Union et ses institutions ont-elles déjà commencé à construire les prémices de leur défense commune? C’est le sujet de notre enquête.
Les cinq sociétés qui se taillent la part du lion dans l’attribution des subventions sont basées en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Ces très gros fabricants d’armes sont pieds et poings liés aux gouvernements en plus de travailler main dans la main… avec leurs concurrents. Ils sont également détenus en partie par des fonds d’investissement américains qui ont également des parts chez leurs principaux concurrents Outre-Atlantique. Des preuves de l’hyperconcentration d’un marché qui se concentre entre les mains de quelques géants de l’industrie, un vrai problème en matière de concurrence et de transparence selon les expert.e.s.
Le projet phare de la stratégie militaire européenne, c’est l’Eurodrone. C’est là que s’est concentrée la plus grande partie des fonds publics de l’UE et ce, même s’il reste bloqué depuis plus de dix ans dans sa phase d’« étude de conception». Et ce drone ne semble pas tapé dans l’oeil de beaucoup d’investisseurs. Nos recherches montrent que jusqu’à présent, seuls les pays ayant participé à son développement ont exprimé leur volonté de l’acheter. Tous les autres États membres hésitent encore, ou, ont carrément rejeté le projet.
Qui est amené à contrôler les nouvelles structures de défense européennes et les sommes qui leur seront allouées ? Le Parlement européen, la seule institution directement issue du suffrage universel, est maintenu à l’écart. « Nous, le Parlement européen, sommes sciemment exclu.e.s des discussions », critique Hannah Neumann, députée européenne allemande des Verts, qui appartient à la sous-commission « sécurité et défense ». «* La majorité des discussions sont tenues secrètes* ».
Alors que la guerre en Ukraine soulève la question d’une politique de défense commune, des failles de coordination apparaissent dans la défense européenne. Les États membres mettent en oeuvre des stratégies parfois même contradictoires. La Grèce et la Turquie sont en conflit depuis des décennies sur la souveraineté de Chypre et plusieurs îles de la mer Égée. Cette « guerre froide » nourrit une situation de grande tension qui explique le budget important de la Grèce en matière de défense, même quand le pays est touché par la crise économique. Mais deux grands alliés européens ont su tirer profit du conflit. D’un côté, la France qui vend des armes à la Grèce et de l’autre, l’Allemagne qui fournit des équipements militaires à la Turquie.
Même la plus longue mission européenne de maintien de la paix, au Mali, a échoué. Les forces européennes ont quitté le pays après l’expulsion de l’ambassadeur français. Le gouvernement malien, dominé par les militaires, a fait appel aux mercenaires russes de Wagner.
Quant à l’éventualité d’une armée européenne, seul le gouvernement allemand l’appelle de ses vœux et la considère comme un « objectif à long terme ». Des « groupements tactiques », composés de 1500 hommes, sont toutefois censés être opérationnels depuis 2007. Il s’agit de groupes d’actions rapides formés de soldats provenant de plusieurs pays, et chargés de gérer les crises extérieures à l’UE. Deux bataillons restent à disposition continuellement, avec des rotations de six mois. Ils sont censés pouvoir être déployés sous 5 ou 10 jours. Mais le dispositif n’a jamais été mis en place, car le financement des bataillons fait débat et parce que les États membres ne sont pas d’accord sur les modalités de son déploiement.
Quand nous avons tenté de rencontrer le groupement tactique actuellement stationné en Italie, nous n’avons pas obtenu de réponse. Un porte-parole de l’armée italienne a même fini par nous expliquer qu’il avait dû se renseigner pour savoir de quoi il s’agissait. Avec l’invasion de l’Ukraine, Vladimir Poutine a fait davantage pour l’unité militaire européenne que ne l’ont fait des décennies d’initiatives et de négociations européennes.
Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à une politique de défense commune. Et il faudra attendre encore plus longtemps, sans doute, pour que l’Europe des armes, soit transparente et contrôlée de manière démocratique
Articles à lire sur notre site
Chez nos partenaires medias

Países de la UE exportaron armas a Rusia después del embargo de 2014
infoLibre, Spain
31 décembre 2022

EU-trained soldiers responsible for deaths of civilians in Mali
OpenDemocracy, UK
9 mai 2022

Once claves sobre la creciente militarización de la UE
infoLibre, Spain
2 avril 2022

Los países de la UE rechazan menos del 1% de las solicitudes para exportar armas
infoLibre, Spain
2 avril 2022

La lucha contra el comercio de armas con Arabia Saudí en los puertos europeos
infoLibre, Spain
1 avril 2022

Putin samler EU militært
Klassekampen, Norway
30 mars 2022

EU-våpen får luft under vingene
Klassekampen, Norway
29 mars 2022
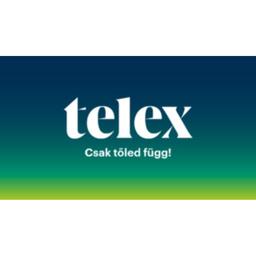
Mit tett eddig Európa azért, hogy képes legyen magát megvédeni?
Telex, Hungary
28 mars 2022

El Fondo de Apoyo a la Paz: un arma sin garantías en manos de la UE
infoLibre, Spain
28 mars 2022

Un pequeño grupo de empresas se beneficia de la mayor parte del dinero que la UE destina a defensa
infoLibre, Spain
28 mars 2022

Europejska siła, czyli projekt o prędkości lodowca. “Kiedy nie ma sprzętu, dyskusja jest nieco jałowa”
Gazeta Wyborcza, Poland
28 mars 2022

Wojna o pokój
Frontstory, Poland
27 mars 2022

Genova, Amburgo e gli altri. Tutti i porti delle tratte armate
Il Fatto Quotidiano, Italy
27 mars 2022

Il “Peace fund” che esporta armi. L’esperienza non insegna nulla
Il Fatto Quotidiano, Italy
27 mars 2022

Eurodroni sempre più strategici, ma il mezzo europeo sarà pronto nel 2029
Il Fatto Quotidiano, Italy
27 mars 2022

La Difesa comune Ue non c’è, il regalo per le lobby invece sì
Il Fatto Quotidiano, Italy
27 mars 2022

Vom Friedensprojekt zur Militärmacht:Europa rüstet auf – der große Report
Der Tagesspiegel, Germany
27 mars 2022

O poder militar da UE mede-se em euros, mais do que em tropas
Público, Portugal
26 mars 2022

Δέκα χώρες της Ε.Ε. πουλούσαν όπλα στη Ρωσία παρά το εμπάργκο του 2014
EfSyn, Greece
20 mars 2022

346 Millionen trotz Embargo: Europas dubiose Waffenlieferungen an Putin
Der Tagesspiegel, Germany
18 mars 2022

Embargo a chi? Per anni armi “proibite” alla Russia
Il Fatto Quotidiano, Italy
16 mars 2022

Dix États européens ont exporté des armes vers la Russie après l’embargo de 2014
Mediapart, France
16 mars 2022

Sankcje dziurawe jak sito
Frontstory, Poland
16 mars 2022

Dez países da UE exportaram armas para a Rússia depois do embargo de 2014
Público, Portugal
16 mars 2022

De proyecto de paz a potencia militar: la UE ya destina desde 2017 miles de millones a su rearme
infoLibre, Spain
27 mars 2021
